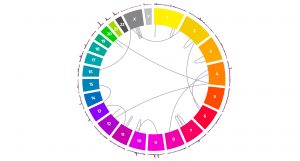PFMG2025 : bilan et poursuite

Le Plan France Médecine Génomique (PFMG2025) a été lancé en 2016 pour positionner la France parmi les pays leaders de la médecine génomique. Son déploiement a permis depuis son lancement l’accès à un examen pangénomique à 50 000 patients. Alors que ce premier plan s’achève, le ministère en charge de la santé, et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche travaillent dès à présent à préparer la suite.
Une mission d’évaluation a été confiée conjointement à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR). Cinq inspecteurs ont été mandatés pour dresser une évaluation rétrospective complète du plan et formuler des préconisations de grandes orientations prospectives d’un futur plan. Leurs travaux visent à identifier les réussites, mais aussi les points d’amélioration pour un futur plan, afin de consolider les acquis et répondre aux nouveaux défis de la médecine génomique.
Afin de compléter les travaux des inspections, trois personnalités scientifiques qualifiées ont été nommées par les ministères : la Pre Frédérique Penault-Llorca (Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand), le Pr David Geneviève (CHU de Montpellier), et le Pr Alexandre Raymond (Université de Lausanne). Ces personnalités ont pour mission d’établir une prospective sur le plan scientifique. Pour cela elles s’appuieront sur des groupes de travail (en cours de constitution), afin de rassembler la communauté scientifique et médicale autour d’objectifs partagés.
Les ministères attendent de ces deux volets – évaluation et perspectives – la production prochaine d’un rapport conjoint qui servira de base au lancement d’un nouveau plan national.
L’année 2026 sera donc une année charnière entre continuité des actions déjà engagées et définition d’une stratégie cohérente afin que la France poursuive sa mission d’assurer aux patients un accès étendu aux innovations que représente la médecine génomique pour le diagnostic et la prise en charge personnalisée.
Projet RNUs : un exemple emblématique du continuum diagnostic-recherche permis par le PFMG2025
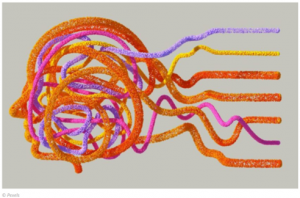
Les troubles du développement intellectuel (TDI) concernent environ 1 % de la population. Bien que plus de 1 600 gènes soient déjà connus comme impliqués dans ces troubles, une large part des patients atteints reste inexpliquée. En juin,
un communiqué de presse de l’Inserm parlait déjà de la mise en évidence du rôle majeur dans les troubles du neurodéveloppement de 2 nouveaux gènes,
RNU4-2 et
RNU5B-1, grâce à une mobilisation internationale rendue possible par le
Plan France Médecine Génomique 2025 (PFMG2025). Cette publication a été réalisée dans le tempo de la recherche internationale et du groupe anglais à l’origine de la découverte du syndrome ReNU.
Le projet
RNUs est né en février 2024, lors d’une discussion entre chercheurs français autour d’une variation génétique atypique. Absente des bases de données mondiales, cette variation a pourtant été retrouvée à 25 reprises dans les données d’AURAGEN. Rapidement, SeqOIA a confirmé des observations similaires. Cette convergence a déclenché la mise en place d’un projet de recherche structuré, mobilisant la communauté de recherche française étudiant les maladies rares.
La coordination s’est organisée autour de pôles d’expertise : Nantes pour les analyses RNAseq, Rouen pour l’étude de méthylome, Strasbourg pour la caractérisation structurale, Paris (ICM/SeqOIA) et Grenoble (AURAGEN) pour coordonner la collecte clinique et génétique. Cette approche collaborative a inclus consentement des patients, collecte des données cliniques et partage d’expertise.
Au total,
plus de 150 patients (dont environ 80 patients français) porteurs de mutations de novo dans l’un des deux gènes ont été identifiés, avec des symptômes tels que retard intellectuel sévère, microcéphalie et épilepsie résistante. Ces résultats ont conduit au développement de nouveaux outils diagnostiques complémentaires au séquençage : analyses transcriptomiques et épigénétiques, capables de révéler des mutations non détectées par les approches classiques. Ces résultats ont tout de suite eu des implications pour les patients et leurs familles, avec une dynamique
nationale et
internationale importante.
Le travail se poursuit à présent en explorant l’impact des variations récessives du gène
RNU4-2, mais aussi des variations d’autres RNUs, dont
RNU2-2. Ces travaux concernent un peu moins d’une centaine de patients, majoritairement identifiés à travers le PFMG2025 et sont en cours de publications.
Les résultats du projet RNUs, publiés ou en cours de publication dans des revues scientifiques majeures (
Nature,
Nature Genetics,
Nature Medicine), prouvent l’importance de cette dynamique internationale en étroite collaboration avec des équipes d’Allemagne, du Royaume-Uni, du Canada, d’Australie ou encore des États-Unis. Cette dynamique se poursuit pour répondre aux nouvelles questions de recherche soulevées par ce projet.
Par la réanalyse ciblée de génomes déjà séquencés de plusieurs milliers de patients, le PFMG2025 a ainsi constitué un effet levier pour la recherche nationale, permettant de mener des projets d’envergure
internationale, grâce à la mise en commun des données françaises avec celles d’équipes étrangères, augmentant la puissance statistique et la portée scientifique.
Le séquençage du génome entier n’est plus une simple innovation technologique : il devient un outil central de la médecine de précision. Il permet de sortir de l’impasse diagnostique, d’améliorer le conseil génétique, et d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Le projet RNUs illustre à quel point la mise en réseau d’expertises cliniques, technologiques et internationales, rendue possible par le PFMG2025, peut transformer à la fois la recherche et le soin.
En révélant l’implication de nouveaux gènes jusque-là insoupçonnés, et en développant des outils diagnostiques adaptés, cette initiative marque une étape majeure : offrir aux patients et à leurs familles des réponses, mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques pour demain.
Publications :
- De novo variants in the RNU4-2 snRNA cause a frequent neurodevelopmental syndrome
Y Chen
et al, Nature, 2024. doi: 10.1038/s41586-024-07773-7
- Dominant variants in major spliceosome U4 and U5 small nuclear RNA genes cause neurodevelopmental disorders through splicing disruption
- Nava et al, Nat Genet, 2025. doi: 10.1038/s41588-025-02184-4.
- Saturation genome editing of RNU4-2 reveals distinct dominant and recessive neurodevelopmental disorders
J De Jonghe
et al, medRxiv [Preprint], 2025. doi: 10.1101/2025.04.08.25325442.
- Systematic analysis of snRNA genes reveals frequent RNU2-2 variants in dominant and recessive developmental and epileptic encephalopathies
Leitão E et al
, medRXIV, 2025. doi: 10.1101/2025.09.02.25334923.
- Biallelic variants in the non-coding RNA gene RNU4-2 cause a recessive neurodevelopmental syndrome with distinct white matter changes
Rius R et al
, medRXIV, 2025. doi: 10.1101/2025.08.13.25333306.
Cas clinique : tumeur pédiatrique rare et complexe
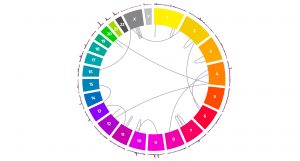
Patiente de 7 ans, prise en charge pour une tumeur cérébelleuse rare avec un profil moléculaire évocateur d’un syndrome de prédisposition génétique.
Une patiente de 7 ans est hospitalisée pour un syndrome d’hypertension intracrânienne. L’imagerie révèle une tumeur de l’hémisphère cérébelleux droit avec hydrocéphalie obstructive. La première hypothèse diagnostique est celle d’un médulloblastome, mais la tumeur reste d’aspect indifférencié et ne correspond à aucun profil moléculaire connu en immunohistochimie. La présence de taches café au lait cutanées est compatible avec un diagnostic de CMMRD (Constitutional Mismatch Repair- MMR- Deficiency : déficit constitutionnel du système de réparation des mésappariements de l’ADN), mais il n’y a pas de perte d’expression des protéines MMR en immunohistochimie.
Les premières analyses réalisées localement sur un panel ciblé montraient un profil moléculaire complexe, avec notamment une mutation pathogène du gène POLE, appartenant au système de réparation de l’ADN. La difficulté à classer cette tumeur selon les données de méthylation des bases de données internationales souligne la rareté de cette entité.
Dans le cadre du PFMG2025, un séquençage pangénomique est réalisé sur le
LBM-FMG AURAGEN. L’analyse somatique confirme une signature mutationnelle de type SBS10 associée à l’inactivation de l’activité exonucléase de POLE, avec une très forte charge mutationnelle (227 mutations/Mb) et à une instabilité microsatellitaire (MSI) à la limite de la positivité.
Sur la base de ces résultats, un traitement par immunothérapie (inhibiteur de checkpoint anti-PD1) est initié. Parallèlement, l’analyse constitutionnelle retrouve le variant pathogène constitutionnel de POLE, justifiant l’orientation de la patiente et de sa famille vers une consultation d’oncogénétique.
Ce cas illustre l’apport déterminant du séquençage à très haut débit dans le cadre du PFMG2025 pour le diagnostic et la prise en charge de tumeurs pédiatriques rares et complexes. Il a permis la mise en place d’un traitement innovant par immunothérapie et a déclenché une enquête génétique familiale ciblée sur un syndrome de prédisposition aux cancers.


 Le Plan France Médecine Génomique (PFMG2025) a été lancé en 2016 pour positionner la France parmi les pays leaders de la médecine génomique. Son déploiement a permis depuis son lancement l’accès à un examen pangénomique à 50 000 patients. Alors que ce premier plan s’achève, le ministère en charge de la santé, et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche travaillent dès à présent à préparer la suite.
Une mission d’évaluation a été confiée conjointement à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR). Cinq inspecteurs ont été mandatés pour dresser une évaluation rétrospective complète du plan et formuler des préconisations de grandes orientations prospectives d’un futur plan. Leurs travaux visent à identifier les réussites, mais aussi les points d’amélioration pour un futur plan, afin de consolider les acquis et répondre aux nouveaux défis de la médecine génomique.
Afin de compléter les travaux des inspections, trois personnalités scientifiques qualifiées ont été nommées par les ministères : la Pre Frédérique Penault-Llorca (Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand), le Pr David Geneviève (CHU de Montpellier), et le Pr Alexandre Raymond (Université de Lausanne). Ces personnalités ont pour mission d’établir une prospective sur le plan scientifique. Pour cela elles s’appuieront sur des groupes de travail (en cours de constitution), afin de rassembler la communauté scientifique et médicale autour d’objectifs partagés.
Les ministères attendent de ces deux volets – évaluation et perspectives – la production prochaine d’un rapport conjoint qui servira de base au lancement d’un nouveau plan national.
L’année 2026 sera donc une année charnière entre continuité des actions déjà engagées et définition d’une stratégie cohérente afin que la France poursuive sa mission d’assurer aux patients un accès étendu aux innovations que représente la médecine génomique pour le diagnostic et la prise en charge personnalisée.
Le Plan France Médecine Génomique (PFMG2025) a été lancé en 2016 pour positionner la France parmi les pays leaders de la médecine génomique. Son déploiement a permis depuis son lancement l’accès à un examen pangénomique à 50 000 patients. Alors que ce premier plan s’achève, le ministère en charge de la santé, et le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche travaillent dès à présent à préparer la suite.
Une mission d’évaluation a été confiée conjointement à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR). Cinq inspecteurs ont été mandatés pour dresser une évaluation rétrospective complète du plan et formuler des préconisations de grandes orientations prospectives d’un futur plan. Leurs travaux visent à identifier les réussites, mais aussi les points d’amélioration pour un futur plan, afin de consolider les acquis et répondre aux nouveaux défis de la médecine génomique.
Afin de compléter les travaux des inspections, trois personnalités scientifiques qualifiées ont été nommées par les ministères : la Pre Frédérique Penault-Llorca (Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand), le Pr David Geneviève (CHU de Montpellier), et le Pr Alexandre Raymond (Université de Lausanne). Ces personnalités ont pour mission d’établir une prospective sur le plan scientifique. Pour cela elles s’appuieront sur des groupes de travail (en cours de constitution), afin de rassembler la communauté scientifique et médicale autour d’objectifs partagés.
Les ministères attendent de ces deux volets – évaluation et perspectives – la production prochaine d’un rapport conjoint qui servira de base au lancement d’un nouveau plan national.
L’année 2026 sera donc une année charnière entre continuité des actions déjà engagées et définition d’une stratégie cohérente afin que la France poursuive sa mission d’assurer aux patients un accès étendu aux innovations que représente la médecine génomique pour le diagnostic et la prise en charge personnalisée. 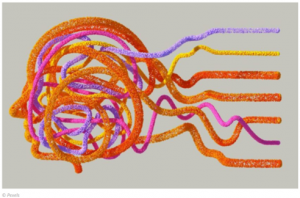 Les troubles du développement intellectuel (TDI) concernent environ 1 % de la population. Bien que plus de 1 600 gènes soient déjà connus comme impliqués dans ces troubles, une large part des patients atteints reste inexpliquée. En juin,
Les troubles du développement intellectuel (TDI) concernent environ 1 % de la population. Bien que plus de 1 600 gènes soient déjà connus comme impliqués dans ces troubles, une large part des patients atteints reste inexpliquée. En juin,